Vous êtes reconnu comme l’un des grands penseurs de l’urbanisation planétaire. Vos travaux montrent comment ce processus global affecte les réalités locales. Pouvez-vous expliquer cette perspective à partir de laquelle vous abordez l’organisation des sociétés ?
Dans tout mon travail, j’essaie de lier en permanence deux échelles : la saisie globale et la saisie micro-locale. Mon travail consiste donc à analyser, d’un côté, l’urbanisation comme processus terra-formateur, et de l’autre, la manière dont les cohabitations individuelles sont imprégnées, subverties, bouleversées par ses logiques.

C’est ainsi que pour moi, l’urbanisation englobe l’ensemble de nos espaces : nul n’y échappe, même ceux qui paraissent non urbains. La campagne elle-même est intégrée à ce système. Depuis les années 50, comme annonçait Henri Lefebvre dès 1970 dans La Révolution urbaine, cette urbanisation planétaire bouleverse tous les espaces-temps des sociétés humaines : de l’individu jusqu’à la planète entière. Elle a transformé les espaces, l’organisation des sociétés, les systèmes productifs, les cultures habitantes, les imaginaires.
Quel diagnostic cette approche vous permet-elle de poser aujourd’hui sur l’état de nos territoires ?
On nous annonçait que cette urbanisation généralisée allait améliorer la qualité de vie pour toutes et tous, que les systèmes urbains mis en place depuis un demi-siècle deviendraient sans cesse plus fonctionnels, plus performants, plus puissants. Or, le compte n’y est pas. On fait face à ce que j’appelle l’insoutenabilité de l’habitation humaine de la planète Terre.
L’urbanisation est mise au service d’un idéal d’une croissance sans fin.

Cette insoutenabilité se manifeste à toutes les échelles et synchroniquement. Puisque l’urbanisation est mise au service d’un idéal d’une croissance sans fin, nous devons être de plus en plus extractifs, intensifs dans l’exploitation des ressources et dans les processus de production. Or, ce refus de reconnaître les limites nous conduit à une insoutenabilité économique. Une vision folle, en réalité, qui nous éloigne de ce que pourrait être, pour reprendre l’expression de l’anthropologue David Graeber, une véritable « économie humaine ».
On constate également une insoutenabilité sociale. La pandémie de Covid-19 a révélé l’inconfort de nos vies urbaines ; l’extrême pauvreté demeure très présente à travers le monde ; les inégalités sociales ne reculent pas comme prévu. Quant aux aménités urbaines promises par la métropolisation, pour une majorité de citadins, elles ne compensent pas les difficultés d’existence, et certains services essentiels tendent même à se dégrader. À l’inverse, pour une élite sociale et économique, elles n’ont jamais été aussi fortes, avec des résidences luxueuses, sécurisées et des équipements culturels somptueux.

Le « compte n’y est pas » non plus du côté de la solidité et de la soutenabilité des organisations urbaines. Partout dans le monde, on observe que ces ensembles urbains, présentés comme des édifices de puissance sans équivalent dans l’histoire, sont en réalité surexposés aux aléas climatiques, aux accidents, aux catastrophes urbaines. Cette surexposition témoigne d’une vulnérabilité accrue, produite par l’urbanisation planétaire elle-même qui remet directement en question la soutenabilité écologique de nos organisations.
Et j’ajoute une quatrième dimension : l’insoutenabilité politique. On voit que les conditions sociales, économiques et écologiques créées par l’urbanisation planétaire fragilisent les équilibres politiques. Elles menacent les libertés et les démocraties, y compris là où elles paraissent les plus solides. C’est donc la convergence de ces insoutenabilités qui m’amène à dire que nous sommes devant une crise majeure de l’habitabilité.
Puissance, performance, individualité, et violence : une combinaison qui nous mène à l’insoutenabilité écologique, économique, sociale et politique.
Comment en sommes-nous arrivés à ces insoutenabilités que vous décrivez ?
Pour moi, une des raisons majeures de ces crises tient aux imaginaires et aux idéologies qui structurent nos sociétés. Ce qui me frappe particulièrement, c’est la place prise par l’imaginaire de la puissance : puissance économique, industrielle, technologique, militaire, physique… À cet imaginaire de la puissance se couple celui de la performance : il faut toujours être plus efficace, plus rapide, plus compétitif. S’y ajoute l’imaginaire de l’individualité souveraine, qui affirme que l’individu doit se suffire à lui-même, s’émanciper de toute dépendance à autrui.
Puissance, performance, individualité, et la violence qui les accompagne souvent, sont ainsi devenues des imaginaires constituants de nos systèmes. Et c’est précisément cette combinaison qui nous mène à l’insoutenabilité écologique, économique, sociale et politique.
Comment le care devient une réponse face à ces insoutenabilités ?
Il me semble que la seule manière d’affronter cette crise est d’en appeler à un bouleversement total de nos régimes d’habitation. Et c’est là que je propose de mobiliser le care comme ressource conceptuelle et pratique pour penser la réorientation nécessaire de nos modalités de cohabitation.
Dans la philosophie du care, j’ai trouvé de quoi subvertir l’imaginaire dominant en lui opposant d’autres valeurs. À la puissance, je substitue la vulnérabilité comme valeur, en lien avec les travaux de Cynthia Fleury et sa notion de « générativité du vulnérable ». À la performance, je préfère la robustesse : privilégier des formes moins optimisées en apparence, moins performantes, mais plus solides, inspirées des recherches du biologiste Olivier Hamant sur « la robustesse ». Et à l’autonomie souveraine, je substitue l’interdépendance, ou si l’on veut, la coopération, qui est une valeur centrale du care.
C’est en articulant ces trois axes — vulnérabilité, robustesse, interdépendance — que je propose de penser une cohabitation nouvelle. Et c’est ce qui me conduit à définir ce que j’appelle le geocare : une forme particulière du care, destinée à rendre soutenables des cohabitations aujourd’hui menacées par l’insoutenabilité.
Comment avez-vous développé votre propre notion du care, le geocare ? Que signifie pour vous ce préfixe « géo » ?
Je voulais employer une expression pour désigner le care appliqué aux espaces de cohabitation. J’ai préféré geocare à care spatial que je proposais initialement, parce que cette formule me permettait à la fois de continuer à interroger le care appliqué au quotidien, et d’élargir la réflexion.
Dans geocare, il y avait deux autres dimensions qui m’intéressaient. La première, c’était l’idée qu’en réorientant nos usages quotidiens des espaces de vie, on pouvait aussi agir sur l’habitabilité de la planète entière. C’est sans doute utopique de parler d’un care à l’échelle globale, mais l’ambition est bien là : penser un care qui concerne l’ensemble de la Terre. Et pour un géographe, le préfixe « geo » renvoie évidemment à ce système-Terre, cher à notre discipline.
La seconde dimension tient à ce que j’appelle les imaginations géographiques. Pour cohabiter, nous avons besoin d’imaginaires géographiques, c’est-à-dire de représentations qui nous permettent de donner sens aux espaces, d’y projeter des valeurs. La cohabitation est toujours une affaire d’imaginaires, et geocare me semble mieux à même de porter cette dimension symbolique et culturelle. D’ailleurs, votre nom, Lumières de la Ville, est une très belle titulature qui renvoie directement à des imaginaires.
Au départ, mon approche du care s’est fondée sur les deux dimensions sémantiques présentes dans l’usage anglo-saxon du terme. La première, celle de to care about, renvoie à l’attention portée à autrui, à cette vigilance tournée vers l’autre. La seconde, celle de to take care of, concerne plus directement la question du soin.

J’ai ensuite affiné cette approche en s’appuyant sur des expériences très concrètes menées par des groupes sociaux comme les peuples autochtones, zadistes, activistes américains, les collectifs à Dijon, etc. Je considère ces mobilisations comme de véritables expérimentations in situ qui testent d’autres façons d’assumer ce travail infra-ordinaire de la cohabitation. J’en suis venu à proposer de caler l’analyse non plus seulement sur les deux dimensions du verbe to care, ni sur le seul registre du soin, mais sur quatre vertus cohabitantes. Le geocare désigne ce qui peut se développer à partir de la mise en œuvre pratique, par les cohabitants, de ces vertus : la considération, l’attention, le ménagement et la maintenance.
Le geocare désigne ce qui peut se développer à partir de la mise en œuvre pratique, par les cohabitants, de ces vertus : la considération, l’attention, le ménagement et la maintenance.
En effet, vous désignez quatre vertus cohabitantes du geocare qui pour vous définissent les valeurs selon lesquelles nous cohabitons avec l’autrui. Pouvez-vous expliquer comment elles offrent une sortie de ces crises d’insoutenabilité ? Et quel lien faites-vous avec les principes de l’urbanisme du care ?
Les quatre vertus que je propose s’organisent en deux couples : deux renvoient à to care about, deux à to take care of. Du côté de to care about, c’est-à-dire de l’éthique du souci et de la sollicitude, je distingue la vertu de considération et la vertu d’attention qui, en réalité, vont toujours ensemble. Je ne peux véritablement considérer que si je suis attentif, et inversement, être attentif exige que je veuille considérer. Prenons l’exemple de la gestion de l’eau : dans le conflit qui oppose les défenseurs des méga-bassines aux écologistes qui cherchent d’autres façons d’habiter et d’utiliser l’eau. On voit bien que l’attention n’est pas seulement une disposition intérieure, c’est une manière d’orienter nos choix collectifs.
Ainsi, considération et attention sont des actes élémentaires, mais leur mise en pratique suppose ce que j’appelle une grande parlementation. Car la considération ne se décrète pas. Elle se construit par la discussion et la reconnaissance mutuelle. Un exemple concret est celui du Parlement de Loire, conduit par Camille de Toledo. Là, on essaye de réfléchir à ce que pourraient être les droits d’un sujet non-humain complexe, en l’occurrence le fleuve Loire.
On est alors très proche de l’urbanisme du care qui me semble justement reposer sur ces deux vertus : attention et considération.
L’autre registre de vertus renvoie cette fois à to take care of. Je les appelle les vertus de l’occupation, ou encore de l’activité occupante. Et là, j’en distingue deux : le ménagement et la maintenance. Le ménagement, c’est ce qui permet de sortir de la logique de la performance et de la puissance performatrice : celle des grands systèmes d’ingénierie, des grandes architectures, des grandes opérations d’urbanisme. Pour moi, le ménagement doit remplacer l’aménagement. Et c’est là que je situe l’urbanisme du care.
La quatrième vertu, c’est la maintenance, que j’ai introduite plus récemment dans mon travail. Elle est liée à ma lecture du livre de Denis et Pontille, Le soin des choses [un article à retrouver prochainement sur Lumière de la Ville]. La maintenance, c’est ce qui permet de repenser notre rapport à la nouveauté et à l’usagé. Autrement dit, ce sont toutes les activités qui consistent à faire durer. Permettre de faire durer, c’est une des clés de la soutenabilité. On revient là au concept de durabilité, mais pas dans le sens falsifié du développement durable.
Le ménagement doit remplacer l’aménagement, c’est là que je situe l’urbanisme du care.
Quels sont les obstacles à relever et les opportunités à saisir afin de créer une cohabitation qui relève du geocare ?
Dans la conclusion du livre, le dernier sous-chapitre s’intitule I have got the blues. J’y exprime sans détour un certain pessimisme les structures étatiques qui sont aujourd’hui davantage un problème qu’une réponse aux défis de la soutenabilité, car elles n’ouvrent jamais la voie à une véritable réorientation de nos cohabitations. Je crois donc que l’impulsion doit venir des cohabitants eux-mêmes. Mon livre est un ouvrage engagé, qui invite chaque lecteur à accepter l’expérience de pensée que je propose : se dire “oui, je pourrais changer ma manière de cohabiter à partir de ces quatre vertus”.
À côté de cet exercice individuel, il y a aussi les expérimentations qui passent par des actions urbanistiques et architecturales inscrites dans des logiques de projet plus classiques. Et ce que je trouve fondamental dans l’urbanisme du care, c’est précisément cette tentative d’entrer dans ces logiques de projet tout en y insérant la subversion du care.
Mon travail consiste à proposer des expériences de pensée et de chercher à convaincre autour de moi que d’autres voies sont possibles. En revanche, je considère qu’il est fondamental de réussir à prendre pied dans le domaine de l’architecture, de l’aménagement, de l’urbanisme, du génie urbain, ou encore de la promotion immobilière. Parce que c’est là que se joue une grande part de la réorientation nécessaire.
Le care ne peut pas faire abstraction des systèmes d’injustice qui existent.
Dans un entretien avec Jean Viard pour la Revue Lumières de la ville (disponible prochainement), il nous disait que le désir d’accéder à une maison avec jardin, de voyager ou tout simplement de « devenir plus riche » restait très légitime pour celles et ceux qui n’y ont jamais eu accès. Comment, selon vous, concilier ce type d’aspirations justifiées avec la responsabilité individuelle de réorienter nos principes de cohabitation ?
C’est là qu’il faut revenir à ce que je disais tout à l’heure sur la quadruple insoutenabilité, et en particulier l’insoutenabilité sociale et politique. Le care ne peut pas faire abstraction des systèmes d’injustice qui existent. Mais en même temps, on doit rappeler qu’une des voies vers plus de justice n’est pas forcément de rendre tout le monde plus riche, au sens où l’entend l’idéologie dominante du capitalisme.
Je me souviens, au moment des Gilets jaunes, de discussions avec certains manifestants sur les ronds-points : ce qui revenait en premier, ce n’était pas tant la question de la richesse matérielle que celle du défaut de considération. L’un des enjeux du care, c’est justement d’inviter tout le monde à la table de la considération.
Jean Viard a tout à fait raison quand il invite à écouter ceux qui disent « j’ai envie de vivre dans le périurbain, parce que…. » Mais plutôt que de les juger, je vais essayer de comprendre ce que ça veut dire en termes d’aspirations à la cohabitation. Et ensuite, je vais me demander : dans quelles conditions pourrait-on répondre à ces aspirations, mais autrement que dans la logique extractiviste et énergivore de la périurbanisation actuelle ?
Si on adoptait toutes et tous le geocare ? Comment serait le quotidien d’une personne ordinaire ?
Beaucoup de choses seraient différentes. On aurait relocalisé une grande partie des espaces de production et on serait beaucoup moins dépendants des réseaux numériques et de tous ces systèmes d’oppression liés à l’usage du temps. Les mobilités se feraient surtout à l’échelle piétonnière ou cycliste. La coopération serait au cœur de la gestion des services sociaux, du fonctionnement des écoles, des établissements de santé. Dans chaque quartier, il y aurait des lieux de culture où les habitants s’engageraient activement. On trouverait partout des ateliers de maintenance, et les habitats seraient pensés de manière coopérative et partagée.
D’ailleurs, les habitants le savent. Ils voudraient parfois changer, mais n’en ont pas les moyens, car rien n’est organisé pour que ce soit possible — et encore moins pour que cela le soit progressivement. Il y a là aussi l’échec d’un certain activisme politique, qui tend à considérer que si l’on ne fait pas une réorientation totale, alors on n’a rien fait. Or, entrer dans le care, c’est aussi une démarche d’apprentissage, une démarche didactique. Elle oblige à entendre des paroles sur la cohabitation qui ne sont pas celles, habituelles, des « donneurs de leçons » que nous sommes parfois, nous les universitaires. Finalement, si l’on prend vraiment au sérieux l’idée du geocare, alors tout est renversé.
Propos recueillis par Fanny Bézie

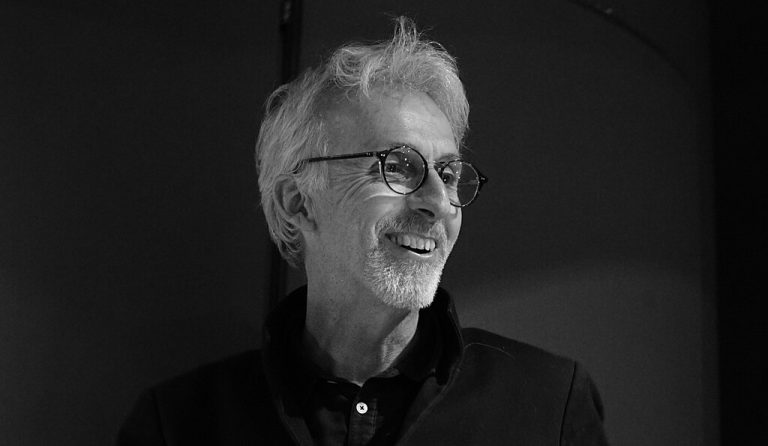




Partager cet article