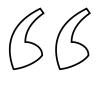 Les épreuves de philosophie se sont déroulées mercredi dernier. Des milliers d’élèves de terminale ont planché durant quatre heures.
Les épreuves de philosophie se sont déroulées mercredi dernier. Des milliers d’élèves de terminale ont planché durant quatre heures.
Trois sujets au choix, dont deux de dissertation.
Nous avons proposé à nos contributeurs de plancher sur le sujet de leur choix, parmi les sujets tombés le jour J.
Une seule consigne : L’urbain comme seul prisme !
Voici la « copie » rendue par Laurent Alberti, qui a traité le sujet donné aux élèves de Terminale L :
« Suis-je ce que mon passé a fait de moi ? »
Suis-je ce que mon passé a fait de moi ?
Autant de suite l’avouer, je ne me suis pas enfermé quatre heures pour rédiger cette copie, non plus que je ne me suis privé de consulter quelques ouvrages en cours de rédaction…. Alors, quitte à ne pas respecter scrupuleusement les règles de l’exercice, autant pousser la logique jusqu’au bout, et transformant légèrement la question en une autre, plus spécifique de nos préoccupations :
La ville est elle ce que son passé fait d’elle ?
Pour le dire autrement : quel est, en France et aujourd’hui, le rapport que les villes entretiennent à leur passé ?
L’intérêt de la question est qu’elle renvoi vers la notion actuelle de patrimoine, notion qui semble aujourd’hui avoir remplacée celle de la donne historique, par un tour de passa-passe qu’a bien décrit Françoise Choay dans ses différents ouvrages, notamment son texte introduisant l’anthologie « Le patrimoine en question » (éditions du Seuil, Paris, 2009)
Ce rapport des villes à leur propre histoire se mesure -entre autres- à leur capacité à prendre en compte les aménagements issus du passé. Pour le dire autrement, la continuité entre passé et présent passe par la capacité à conserver, dans une logique de réemploi, les constructions ou les quartiers anciens.
Il faut sortir de « la querelle entre les anciens et les modernes », qui incarne finalement un autre débat -idéologique, celui-ci. A la place, posons-nous plutôt quelques questions simples :
Quel regard porte-t-on sur le bâti existant issu du passé ?
Quelle réalité la notion de patrimoine recouvre-t-elle ?
La conservation d’un bâtiment ancien est elle compatible avec le cadre actuel de la construction ?
Pour tenter d’y répondre, appuyons-nous sur l’exemple parisien. Non pas par excès de jacobinisme, mais simplement parce que cette ville a souvent été la matrice de phénomènes urbains qui se sont ensuite répandus aux autres métropoles importantes du pays.
D’abord, examinons l’évolution du regard porté sur le bâti dont les villes héritent.
Pour en prendre la mesure, il faut rappeler le tournant idéologique postindustriel, l’abandon par les pouvoirs publics de la doxa du mouvement moderne dans ce qu’elle a de plus radicale, et le travail -spécifiquement parisien- de réappropriation du vocabulaire la « ville traditionnelle ».
Les « trente glorieuses » ont vu les préceptes de l’urbanisme moderne se généraliser. En 1957 le Plan Lopez, avec ses « ilots mal construits », illustre la politique alors en cours qui tend à ne considérer que le seul patrimoine monumental comme digne d’être préservé, ouvrant à la rénovation urbaine un quart du territoire parisien, dans une séquence de l’histoire qui voit s’achever la démolition des 17 « ilots insalubres » et qui instaure, à travers le Plan d’utilisation des sols de 1967, des règles urbaines obligeant au recul de l’alignement toutes les voies, et par la même la démolition de leurs immeubles. L’ensemble de ces dispositifs sera extrêmement destructeur pour le bâti ancien domestique -ou « non monumental ».
L’abandon de ces procédés signifiera le rejet des préceptes du mouvement moderne par les pouvoirs publics, un rejet dont l’origine est à trouver dans le renouvellement des doctrines opéré à la fin des années ’60 et au début des années ’70.
Renouvellement des doctrines urbaines d’abord. En Italie, « la Tendenza » proposera de redéfinir l’architecture selon le prima de la ville Historique, revendiquant l’abandon de l’urbanisme fonctionnaliste au profit d’une approche typo morphologique de la ville. « L’architecture de la Ville » d’Aldo Rossi en 1966 et « Projets et utopies » de Manfredo Tafuri en 1973 fourniront les outils théoriques permettant la remise en question de la Charte d’Athènes et les acquis -ou plutôt les présupposés – de la modernité.
Renouvellement des doctrines architecturales ensuite, illustré par le mouvement post-moderne et ses références à la culture architecturale préindustrielle, qui voit lever l’anathème qu’avait jeté le mouvement moderne sur la prise en compte de l’Histoire et de ses références architecturales. Et Robert Venturi d’écrire en 1976 « l’histoire donne une conscience plus aigüe de son insertion dans le temps, dans sa contemporanéité ».
Un glissement idéologique qui finira par toucher la politique urbaine de l’État, dont l’interventionnisme alors en cours pour toutes les questions touchant à l’aménagement de la Capitale verra Giscard d’Estaing déclarer en 1976 : « le temps du béton à tout prix est passé ».
Illustrant cette prise en compte politique du nouveau paradigme post-moderne, l’arrêt des grandes opérations de rénovations urbaines se doublera du lancement de reconversions emblématiques : la gare d’Orsay reconvertie en musée du XIXe siècle (79-86), ou encore la salle des ventes des abattoirs de la Villette en musée des sciences (1986).
Mais dès 1967, le pouvoir local engage ce revirement à travers la création de L’APUR, qui réalise alors l’étude des morphologies urbaines existantes et servira de base à l’élaboration de la nouvelle réglementation urbaine, le POS de 1977. En lieu et place des grandes opérations de rénovations urbaines dont certaines ne seront jamais achevées, des opérations plus modestes sont alors programmées, au vocabulaire urbain traditionnel.
Ces « années APUR », d’où émergent ce que l’on appellera plus tard l’ « Urbanisme d’Îlot », portent également une certaine vision de la Ville, que certains diront « néo-haussmannienne », dont la préservation du bâti existant prendra souvent la forme d’opération de façadisme où des immeubles annoncés alors comme conservés seront en réalité entièrement vidés de l’intérieur.
On voit donc qu’à partir de l’épisode de la démolition des Halles de Baltard entre 1971 et 73, un changement va s’opérer dans les mentalités au sujet du réemploi du bâti existant, et qui est aujourd’hui une réalité. Mais cette prise en compte tend à privilégie la conservation des parties visibles du bâti depuis la rue, dans une logique de paysage urbain au détriment des parties intérieures et donc de la cohérence architecturale de l’édifice conservé.
Penchons-nous maintenant sur la notion de patrimoine.
L’examen que certains ont mené sur la notion contemporaine de patrimoines montre un domaine qui tout en s’amplifiant, est devenu vague et complexe. Une des premières manifestations de cette extension du domaine patrimonial fut les secteurs sauvegardés issus de la loi Malraux en 1964, qui consacrèrent la notion de « patrimoine urbain » qui dépasse la simple échelle architecturale. Cet élargissement, envisagé dés 1860 par Ruskin et son intérêt pour « l’architecture domestique », traduit l’extension d’un champ autrefois cantonné aux seuls édifices monumentaux, aux constructions plus communes – « l’architecture mineure » disait Giovannoni- des tissus anciens structurés.
Autre sujet d’extension, celui du champ chronologique. Cantonnées initialement aux périodes de l’ancien régime, elles s’étendent à partir des années ’60 au XIXe siècle, puis à la période industrielle.
De lointain, le passé de la ville se rapproche inexorablement de notre présent.
A Paris, si l’on s’arrête à l’examen des labels ou des protections patrimoniales – celles issues du code du patrimoine ou bien du code de l’urbanisme – cette inflation est incontestable : aujourd’hui, son territoire est couvert par deux secteurs de PSMV, 1800 protections MH (inscrites ou classé) et trois quarts de ses parcelles sont situés en site inscrit ou classé. Ce à quoi s’ajoutent les 5000 mesures de protection patrimoniales spécifique au PLU.
A cette « inflation » géographique et chronologique du patrimoine, s’ajoute une source supplémentaire de confusion, due à la multiplicité des acteurs dans le domaine.
Comme l’a montré l’ouvrage de Ruth Fiori « l’invention du vieux Paris », historiquement, il y a toujours eu –si ce n’est une opposition- tout du moins une approche différente entre les acteurs issus des Monuments Historiques et ceux issus des cercles d’historiens, autrefois appelés « érudits ».
Les premiers se sont longtemps positionnés au regard des problématiques esthétiques et de l’histoire de l’art, inclinant le plus souvent vers une posture « Viollet-le-Ducienne », où l’intervention sur le patrimoine architectural tend vers la restitution d’un état idéal ; esthétisé, quitte à modifier largement l’existant.
Les cercles d’érudits, eux, sont les héritiers des sociétés savantes du XIXe siècle pour qui le patrimoine architectural avait une valeur avant tout « documentaire », qui estimaient la restitution d’un état idéal comme n’étant qu’une falsification de l’histoire, puisqu’elle n’avait jamais existé. Ils militent pour l’authenticité, et promeuvent le plus souvent la simple conservation, éventuellement accompagné de mesure de consolidations.
En France, aujourd’hui, les différentes institutions patrimoniales, issues de ces deux mouvances, sont nombreuses. Architectes de bâtiments de France, architectes du patrimoine, architectes en chef des Monuments Historiques, conservateurs régionaux des Monuments Historiques, conservateurs des services de l’inventaire voir historiens de l’architecture responsables des études historiques où même associations de défense du patrimoine… autant d’acteurs qui, même s’ils interviennent sur un champ de compétence à priori bien identifié, créent une disparité de points de vue et ont une perception différente de « ce qui fait patrimoine ». Ce qui rend plus difficile, pour les acteurs de la construction, de cerner le caractère patrimonial des édifices, et donc la manière dont il doit être pris en compte.
Face à ce « théâtre patrimonial » aux multiples acteurs, et à cette prise en compte de plus en plus grande du bâti ancien, il y a une économie de la construction dont l’approche rationalise l’acte de construire ou d’aménager, et un système règlementaire qui en normalise la forme.
Cet environnement génère un ensemble complexe de procédures et de textes de nature diverse, aussi bien administrative, juridique que technique, dont le périmètre tend à toucher de plus en plus de domaines à des niveaux de plus en plus grands, passant de l’échelle nationale à celle européenne, voire mondiale.
Ainsi, les textes législatifs fixent aujourd’hui des niveaux minimaux d’exigences pour tous les bâtiments en matière de sécurité (contre les risques d’incendie), de confort (effets acoustiques, assainissement) ou de l’économie d’énergie. Les normes définissent pour tous les matériaux certaines caractéristiques, les documents techniques unifiés (DTU) récapitulent les règles de l’art pour chaque ouvrage ou partie d’ouvrages, les techniques de mise en œuvre des matériaux utilisés, les avis techniques imposent à toute mise en œuvre leurs contrôles, les certifications se doivent de garantir la conformité des produits tandis que les classes, classements et autres labels attestent du niveau de qualité des matériaux.
De nationales, ces contraintes s’étendent aujourd’hui au champ européen, voire mondial. Ainsi, la directive européenne 2010/31/UE, implique que les états membres de l’Union européenne adoptent de nouvelles règles en matière performance énergétique des bâtiments, et s’inscrit dans un cadre mondial, celui du protocole de Kyoto. Si les monuments historiques sont exclus de son champ d’application, les autres édifices anciens sont néanmoins concernés.
En conséquence de cette « vague normative », le risque est celui d’une tendance à l’uniformisation des solutions spatiales, de mises en œuvre et de matériaux, et de produire in fine ce que Françoise Choay nomme un « univers technicisé et monosémique ».
Le bâti ancien, en ce qu’il est souvent le fruit d’une économie préindustrielle, présente une multiplicité de configurations constructives, typologiques ou spatiales.
Il y a donc une forme de contradiction entre la conservation de la disparité architecturale du bâti ancien et la mise en oeuvre d’un projet soumis à une application d’un environnement administratif et règlementaire homogénéisant.
Il ressort de ce tableau -dont il faut excuser la grosseur du trait- un paradoxe : si de plus en plus de bâtiments anciens sont concernés par des « conservations », la pérennité de ces édifices passe prioritairement par la conservation de leurs dispositions extérieures (volumes, façades, éléments de toitures visibles …), au détriment parfois de leurs structures intérieures – et donc de leur cohérence architecturale.
Si un nombre de plus en plus grand de ces opérations sont revêtues d’une dimension patrimoniale du fait de l’extension de ce champ, la difficulté à définir et donc à respecter ce patrimoine est réelle, tant cette notion se complexifie et trouve des définitions différentes du fait du nombre des acteurs concernés.
Enfin, lorsqu’elles sont engagées avec la volonté de respecter un cadre patrimonial précisément défini, les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrages doivent se confronter à une normalisation qui tend à les empêcher de conserver les spécificité matérielles qui fondent leur statut de « vestiges historiques ».
Un passé dont la vision se brouille par l’extension du champ patrimonial et du nombre de ses porte-paroles, une difficulté parfois insurmontable à combiner logique de conservation et respect des contraintes programmatiques, constructives et réglementaires…
Il semble qu’aujourd’hui, en matière de prise en compte de leur passé, les villes n’en préservent simplement que l’image…







Partager cet article