Face aux défis environnementaux, sociaux et économiques qui pèsent sur nos villes, l’urbanisme doit se réinventer. Construire autrement est devenu une réelle nécessité. Le réemploi et le reconditionnement, justement, offrent des pistes concrètes pour bâtir des villes plus résilientes, durables et inclusives. Une question se pose alors : et si l’avenir de nos villes ne résidait pas dans le neuf, mais dans la transformation de l’existant ?
Au travers de cet article, découvrez en plus sur le réemploi et le reconditionnement, sur leur application en urbanisme et sur certains des projets déjà existants.
Le reconditionnement, ou réemploi, qu’est-ce que c’est ?
Le reconditionnement ou réemploi consiste à donner une seconde vie à un produit, des matériaux, ou encore à un espace grâce à une réhabilitation partielle ou complète.
C’est un concept qui est déjà très présent dans certains secteurs, comme celui de la tech. Acheter un appareil tech reconditionné, comme un iPhone 13, a de nombreux avantages : vous bénéficiez d’un produit aussi performant que s’il était neuf, à moindre coût. De plus, cela vous permet de réduire drastiquement votre empreinte carbone par rapport à un achat neuf.
Aujourd’hui, cette logique de reconditionnement et du réemploi se développe de plus en plus dans l’urbanisme et ouvre la voie à de nouvelles réflexions sur l’aménagement des territoires.
Réemploi des matériaux
Dans le secteur du bâtiment, de plus en plus, on tend à ré-utiliser des matériaux issus de démolitions. Au lieu de tout jeter, les éléments en bon état sont récupérés, triés et remis sur le marché. Cela peut-être des briques, des poutres, du carrelage, des portes, des fenêtres, etc. Des plateformes spécialisées comme Backacia ou Cycle Up facilitent l’identification, la traçabilité et la remise sur le marché de ces composants.
À Villeurbanne, par exemple, la reconstruction de l’IUFM a été réalisée en réutilisant 19% issus de la démolition de l’ancien projet. Cela a permis de limiter les coûts écologiques, énergétiques et économiques que peuvent engendrer l’extraction et l’achat de nouveaux matériaux.
Réhabilitation de lieux laissés à l’abandon
Le recyclage urbain ne se limite pas uniquement à une meilleure maîtrise des ressources et à la réduction de déchets dans le BTP. Il inclut aussi la transformation d’espaces laissés à l’abandon ou destinés à la démolition. En effet, il n’est pas toujours nécessaire de tout détruire pour tout construire. Il peut aussi être intéressant de revaloriser le patrimoine bâti pour lui redonner du sens, de l’utilité et redynamiser les quartiers et les villes.
Les collectivités locales l’ont bien compris et de nombreux projets ont vu le jour. Par exemple, à Bordeaux, l’ancienne caserne Niel a été réhabilitée pour devenir « Darwin Ecosystème ». Aujourd’hui, c’est l’un des endroits les plus fréquentés de la ville.
Le réemploi au service des économies locales
Le réemploi des matériaux et la reconversion des bâtiments favorisent les circuits courts et la croissance de l’économie locale. Les ressources réutilisées sont souvent issues de ruines proches, stockées sur les chantiers et triées par divers acteurs locaux. Cela contribue à la création d’emplois et rend le tissu économique de la ville moins dépendant des grands groupes du BTP, par exemple.
Réemployer et reconditionner, c’est faire le choix d’une ville plus sobre, plus durable et plus résiliente. C’est une alternative concrète aux pratiques existantes, pour un urbanisme plus en phase avec les problématiques actuelles. Pour mieux préparer la ville de demain.


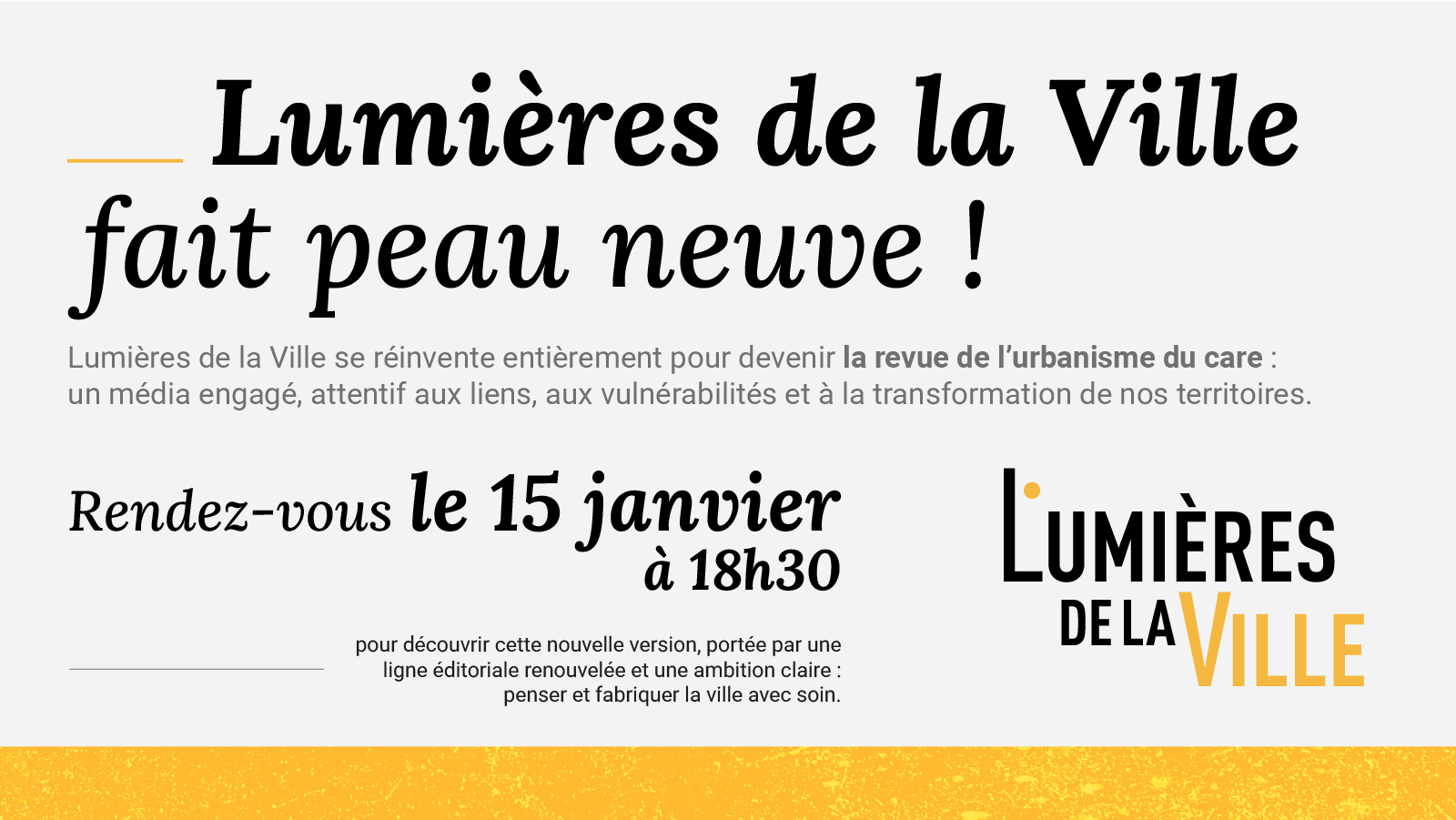

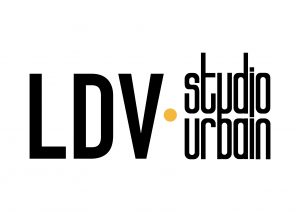

Partager cet article