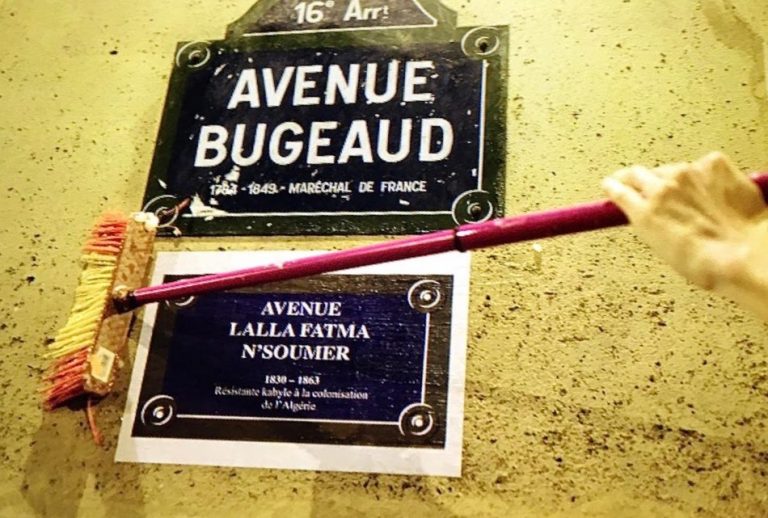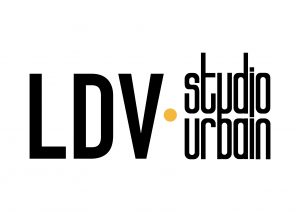La minorité Kurde compte entre 30 et 40 millions de personnes, réparties entre différents pays que sont notamment la Turquie, l’Iran, l’Irak et la Syrie : pour ces pays-là, elle constitue la principale minorité nationale. De la dynastie des Ayyoubides au XIe siècle, à la brève irruption d’un Kurdistan indépendant en Iran de 1844 à 1846, l’histoire des Kurdes remonte à loin. Aujourd’hui, le rêve d’un Kurdistan indépendant persiste, même si il suscite la fervente opposition des États concernés. Il reste un territoire mythique, sans frontières, toujours revendiqué par le Parti des travailleurs du Kurdistan, séparatistes kurdes en Turquie. Au mieux, des régions autonomes, et des maires pro-kurdes dans certaines localités.
Les Kurdes sont aujourd’hui confrontés à différents types de discriminations et de répressions, en témoigne l’intervention de l’armée turque en Syrie au début du mois d’Octobre, entre autres pour limiter l’influence des forces armées kurdes dans cette région limitrophe avec la Turquie.
Diyarbakir et la Turquie
Durant les années 1920, la République de Turquie de Mustafa Kemal s’est affirmée contre le mouvement séparatiste kurde, au profit d’une unité nationale et territoriale. La ville de Diyarbakir, surnommée « Amed » en Kurde, est située dans le Sud-Est du pays, au bord du Tigre, et reste encore aujourd’hui un bastion du mouvement pour l’autonomie et la reconnaissance des droits culturels kurdes. Cette ville de 900 000 habitants est considérée comme la capitale kurde de Turquie, elle est d’ailleurs un refuge pour les ruraux kurdes depuis les années 1980.
Dès le XIe siècle, époque de construction de la Grande Mosquée, les populations kurdes sont présentes dans la région. Durant la Première Guerre mondiale, la ville subit également les conséquences funestes du génocide arménien. En 1979, l’arrivée du PKK à Diyarbakir ne fait que renforcer l’emprise culturelle et démographique kurde sur la ville. Depuis 1999, presque tous les maires qui se sont succédé sont pro-kurdes. Aujourd’hui, cette ville se veut à la fois le théâtre et l’objet des affrontements entre turcs et kurdes, en termes territoriaux certes, mais surtout du fait des enjeux patrimoniaux, historiques et culturels qu’elle représente.
Les enjeux patrimoniaux
La ville est en effet réputée pour son patrimoine culturel riche : elle compte 595 bâtiments historiques en tout. Le 4 Juillet 2015, la forteresse et la vieille ville de Sur, emblématiques de Diyarbakir, sont inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO – institution dans laquelle le Ministère de la Culture et du Tourisme turc est très impliqué, notamment financièrement.
Vieille ville de Diyarbakir ©️Alexandra Roux
Cette labellisation engage d’un côté un projet touristique plus élaboré, de la part du gouvernement local, avec le développement d’équipements et de services touristiques, la mise en tourisme et la valorisation d’un site qui s’étend sur plus de 6000 mètres de périmètre. Ce programme de valorisation touristique participe à mettre en valeur l’histoire culturelle kurde. Mais il se heurte également au désintérêt volontaire de la part des pouvoirs publics, avec certains bâtiments laissés à l’abandon, et peu d’initiatives de rénovation ou de conservation de la part du pouvoir central. Les nombreux conflits armés qui ont lieu au centre-ville participent à endommager les bâtiments, autant qu’à faire fuir les habitants : près de 20 000 personnes auraient quitté la vieille ville depuis les 5 dernières années.
D’un affront territorial à une bataille symbolique
Il y a donc deux tendances contraires, avec une volonté de valorisation patrimoniale qui se heurte, de manière presque simultanée, à la cristallisation des tensions entre le gouvernement local pro-kurde et les autorités turques. L’instauration progressive d’un couvre-feu dans la vieille ville, par exemple, a donné lieu à de nombreuses interventions de l’armée et de la police. Depuis 2015, cette mesure a causé plusieurs morts, ainsi que de lourdes dégradations pour certains bâtiments.
La bataille est aussi symbolique : les forces armées turques viennent étendre le drapeau national dans la vieille ville, là où il était assez peu montré, mais y inscrivent aussi slogans et symboles nationalistes turcs sur les murs. Le patrimoine chrétien est volontairement dégradé, ce qui nuit à l’image multiculturelle et multiconfessionnelle de Diyarbakir.
La ville se fait donc le lieu de revendications identitaires, à la fois de manière concrète – car elle devient un bastion pour la lutte de pouvoir, directement visible par les populations – et de manière symbolique. Instaurer un climat de tensions dans les rues de la vieille ville, tenter de se réapproprier les symboles patrimoniaux et historiques de la ville, qui sont aujourd’hui de renommée internationale, c’est revendiquer culturellement cet espace, autant que territorialement. Mais c’est surtout malheureusement détruire ce qui fait aujourd’hui l’identité et l’urbanité de Diyarbakir, afin de pouvoir mieux l’effacer et en réécrire l’histoire…
De Carthage, en 146 avant Jésus-Christ, à Lhassa ou de Sarajevo au XXe siècle, ce que l’on pourrait nommer « urbicide » s’impose donc, à chaque époque, comme une tactique souvent employée dans les conflits ethniques et politiques. Car les villes sont aussi, et l’on a souvent tendance à l’oublier, le symbole d’enjeux patrimoniaux, mémoriaux et culturels forts, que l’on cherche à détruire en temps de conflits.
Crédit photo de couverture ©Poyraz 72 via Wikipédia