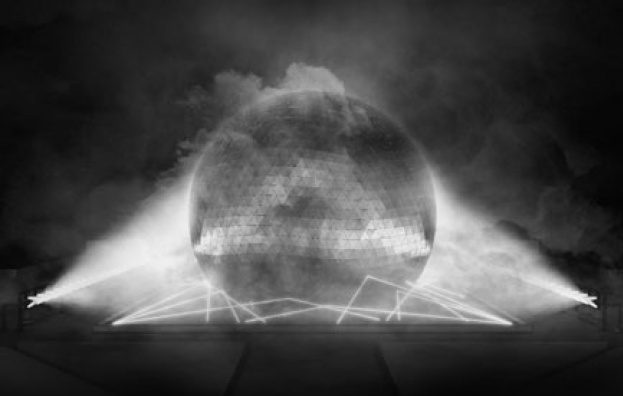Une architecture de la peur
Les villes, et les évolutions de celles-ci, sont au cœur des préoccupations et des imaginaires des cinéastes depuis des décennies. Si elles sont particulièrement mobilisées dans le cadre de la science-fiction, des documentaires ou de films plutôt sociaux, “l’horreur urbaine” peut également constituer un genre à part entière, et ce au moins depuis les années 1920. Le mouvement du cinéma expressionniste allemand, encore étudié aujourd’hui comme précurseur du cinéma moderne, s’est saisi de la dimension de l’horreur et de la peur avec des films comme Le Cabinet du Docteur Caligari, Nosferatu ou même Metropolis, qui sans être un film d’horreur stricto sensu, puise dans le genre de l’horreur gothique.
De nombreux auteurs ont cherché à comprendre pourquoi certains types d’espaces provoquaient plus de peur et d’angoisse que d’autres et plusieurs théories ont alors été élaborées et utilisées par les réalisatrices et réalisateurs de films d’horreur. Parmi celles-ci, la théorie du prospect and refuge, issue des années 1970, établit que les êtres humains ont tendance à se sentir plus à l’aise dans les espaces où ils peuvent observer (prospect) sans pour autant être épiés (refuge). À partir de ces dimensions très rudimentaires, plusieurs architectes se sont intéressés au moyen de renforcer chacun de ces deux critères en jouant sur la lumière, la perspective, la hauteur de plafond, l’ouverture des espaces, etc…
C’est justement pour cela qu’un grand nombre de films d’horreur met en scène des espaces où les protagonistes ne peuvent pas s’échapper ou ont l’impression d’être observés et à la merci d’une présence dangereuse. On pense directement aux architectures labyrinthiques de l’hôtel de Shining ou encore au vaisseau spatial du premier Alien. Ces lieux se définissent par leur complexité avec des espaces imbriqués, un surplus d’informations qui pousse à l’hypervigilance et l’impression qu’il n’existe aucun espace où se réfugier (si ce n’est dans un placard ou sous une table).

Crédit photo ©Getty
Le summum de ce type d’espaces est parfaitement représenté par les maisons victoriennes, décors par excellence des films d’horreur au milieu du siècle dernier dans le cinéma américain. Les toits mansardés, les porches, les épais rideaux invoquent aujourd’hui directement un imaginaire de maison hantée chez le spectateur, alors que ces éléments séduisaient les populations riches dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle.
L’horreur pavillonnaire
Le cinéma d’horreur utilise donc toute une palette de techniques directement inspirées de l’architecture pour susciter l’angoisse chez le spectateur, non pas seulement pour le simple plaisir de faire peur, mais également pour apporter une critique sociale et même urbanistique. Celle-ci se retrouve dans le nombre phénoménal de films qui prennent place dans les suburbs, banlieues pavillonnaires des Etats-Unis.
Ces quartiers et villes pavillonnaires se sont très fortement développés au sortir de la deuxième guerre Mondiale, et encore plus dans les années 1960. C’est à cette période qu’une grande partie de la classe moyenne blanche, qui résidait jusqu’alors dans les centres-villes des grandes villes, a “fui” durant ce qu’on appelle aujourd’hui le white flight vers un cadre de vie qui se voulait idyllique. Les caractéristiques de ce nouveau mode de vie surburbain sont aujourd’hui bien connues : la recherche d’un juste milieu entre l’urbain et le rural, la vie familiale paisible, et l’achat d’un pavillon, accomplissement ultime du rêve américain — depuis largement remis en question jusque dans l’hexagone.

Crédit photo ©Jimmy Conover via Unsplash
Les réalisateurs John Carpenter et Tobe Hooper s’attaquent à deux films cultes dont l’intrigue se déroule dans des suburbs américains : Halloween en 1978 et Poltergeist en 1982. Plus que de simplement utiliser la banlieue comme un décor, ces œuvres en critiquent le mode de vie comme bon nombre de slashers de l’époque. Les classes moyennes blanches; qui se croyaient à l’abri de toute violence dans leurs lotissements tranquilles aux haies bien taillées, se voient se faire attaquer sauvagement par toute une ribambelle de tueurs en séries à commencer donc par Michael Myers dans la série de films lancée par Carpenter.
Le cinéaste utilise notamment un plan tourné par-dessus l’épaule du tueur pour renverser la traditionnelle tranquillité du quartier et de la maison pavillonnaire en mettant en avant cette présence étrangère et menaçante. Myers rentre alors dans différentes maisons, passant de jardin en jardin pour chasser ses différentes victimes, qui n’ont alors plus aucun refuge ni échappatoire possible. Le film est alors célèbre pour plusieurs plans marquants où on peut voir le tueur comme incrusté dans des scènes typiques du rêve suburbain : à proximité d’une petite école de banlieue, derrière des haies parfaitement taillées ou caché par le linge qui flotte sous l’effet du vent dans un petit jardin individuel.
Comme Halloween, Poltergeist de Tobe Hoober, sorti quatre ans plus tard, met en doute la supposée force des liens communautaires et de la solidarité des suburbs américains. La première partie du film nous présente justement cette vision idyllique, ce qui n’est pas étonnant quand on sait que le film a été co-écrit par Steven Spielberg, habitué aux décors suburbains (dans Rencontres du troisième type ou encore E.T.). Il diffère du film de Carpenter puisque ce n’est pas un tueur sanguinaire venu d’ailleurs qui attaque la famille de protagonistes, mais la maison elle-même qui apparaît hantée et torture cette pauvre famille de classe moyenne blanche modèle.
Parmi toutes les horreurs provoquées par la maison, certaines portent un symbolisme fort et une critique assez évidente de ce type de développement urbain. La première d’entre elle tient à la technologie, alors que la benjamine de la famille semble capable de déchiffrer des messages dans le bruit blanc produit par le tube cathodique du téléviseur, résultant dans son abduction par les forces maléfiques de la maison. On trouve là une façon de mettre en lumière la totale dépendance des habitants de ces banlieues aux nouvelles technologies pour s’informer et même interagir. Une critique, qui peut aujourd’hui paraître légèrement technophobe et réactionnaire, également à l’œuvre dans Halloween lorsque une jeune fille se fait étrangler par le fil de son téléphone qu’elle utilise pour communiquer avec ses amies.
La deuxième critique concerne le développement urbain des pavillons en lui-même, alors que l’arbre du jardin se déchaîne et s’attaque directement à la maison. Comme le film l’indique plus clairement à travers le personnage d’un promoteur, les quartiers pavillonnaires ont été construits à coup de bulldozer dans des zones jusque alors non urbanisées sans se poser de question. En l’occurrence dans le quartier de Poltergeist — comme dans de nombreux films d’horreur — c’est sur un ancien cimetière, et donc parmi des restes humains, que l’intrigue se déroule.
Ces deux films subvertissent alors totalement l’imaginaire idyllique des suburbs américains en transformant le quartier et le domicile familial, seule zone de retraite, comme le créateur de l’anxiété.
La gentrification, nouvelle peur urbaine
Si un grand nombre de films d’horreur est resté bloqué dans ce même imaginaire des suburbs, en reprenant les recettes originelles jusqu’à épuisement du concept, des cinéastes d’horreur ont cherché à s’attaquer à des sujets plus contemporains dans nos villes. Parmi tous ces films, Candyman de Bernard Rose sorti en 1992 constitue encore aujourd’hui un cas d’école.
Dans ce film culte, on suit le personnage Helen Lyle, une doctorante de l’université de Chicago qui étudie les légendes urbaines et les croyances populaires. Elle cherche alors à analyser un mythe très présent dans le quartier voisin de Cabrini-Green autour de la figure de Candyman. Selon les habitants, répéter cinq fois le nom « Candyman » devant un miroir invoque fait apparaître un tueur terrifiant muni d’un crochet à la place du bras, qui assassine femmes et enfants.
Le premier intérêt du film est alors qu’il explore le quartier populaire de Cabrini-Green, symbole des housing projects, quartiers de logements sociaux étasuniens. Des quartiers qui ont permis au milieu du vingtième siècle de sortir des millions de personnes des bidonvilles qui se multipliaient dans le pays, et qui étaient donc célébrés par ses nouveaux résidents qui accédaient enfin à un minimum de confort et de services. Malheureusement, ces barres d’immeubles, fréquentées de plus en plus par des populations afro-américaines précaires victimes de fortes discriminations, ont rapidement dépérit et ont concentré un grand nombre de problèmes. Ce film d’horreur présente donc tout d’abord les difficultés d’un quartier abandonné à son sort par la puissance publique et expose la ségrégation raciale qui a perduré bien après l’abolition de Jim Crow.
Mais le film va bien plus loin en montrant comment les perceptions des classes moyennes blanches, y compris celles qui se sont mobilisées contre l’abandon de Cabrini-Green, ont contribué aux problèmes terribles qu’ont vécu les habitants. En effet, la théorie principale de la protagoniste Helen Lyle pour expliquer que les habitants ont inventé le mythe du tueur au crochet, c’est qu’ils chercheraient à rationaliser leur précarité et leurs peurs.

Crédit photo © Eric Allix Rogers via Flickr
À travers cette simple histoire, les créateurs du film critiquent la manière dont les personnes plus aisées ont tendance à pointer du doigt des quartiers comme Cabrini-Green, en les présentant comme des capitales de la criminalité et du meurtre. En effet, si on regarde précisément et qu’on cartographie les endroits où la violence était la plus importante à Chicago, le quartier qui nous intéresse est loin d’être sur le podium (bien qu’il ne faille pas ignorer les problèmes alors présents).
Mais si Cabrini-Green a été désigné comme cette centralité de la violence, c’est avant tout par sa proximité avec le quartier Gold Coast, bien plus huppé et habité par des personnes blanches. En plus de mettre en lumière l’abandon des pouvoirs publics, le film dépeint avec horreur les stigmates imaginaires qui ont été accolés au quartier et qui ont contribué à son déclin … et à son évolution future. Une évolution qui est justement au cœur du nouveau film Candyman de 2021, réalisé par Nia DaCosta et coproduit par Jordan Peele, devenu maître de l’horreur avec ses films Get Out et Us, eux aussi imprégnés de questions sociales et raciales.
Ce reboot de la franchise suit le personnage de Anthony McCoy, un artiste vivant dans un loft de la zone désormais de gentrifiée de Cabrini-Green après avoir grandi dans une des barres de logement social. Il symbolise alors parfaitement ce qu’on présente souvent comme la « première phase » de la gentrification qui précède l’explosion des loyers. Anthony évolue auprès d’un écosystème d’artistes gentrifieurs et leur fait découvrir par une de ses œuvres le mythe de Candyman, qui lui a été raconté par un vieil habitant du quartier. Ces nouveaux habitants, blancs et n’ayant pas grandi dans l’ancien quartier, voit dans cette légende urbaine rien d’autre que du folklore à l’instar de la protagoniste du premier film, et n’hésite pas à répéter cinq fois son nom en toute confiance, avant de se faire tuer sauvagement.
Sans vous l’affront de spoiler un film récemment sorti en salle, on peut quand même signaler que le film s’intéresse également aux mouvements très contemporains aux Etats-Unis de la montée du suprématisme blanc, ou encore des violences policières, et en fin de compte, aux peurs spécifiques à la communauté afro-américaine.
À travers ces quelques exemples, on comprend comment les films d’horreur peuvent se saisir avec une grande justesse des enjeux urbains et sociaux les plus contemporains et mettre en lumière ce qui nous effraie le plus dans nos villes. Une bonne manière de nous donner le courage d’affronter nos peur et les armes pour améliorer nos villes.