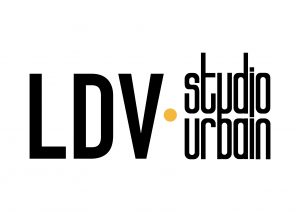Quand la ville se met à la conquête des montagnes
Les sommets de nos reliefs français ont longtemps été une zone vierge de toute urbanisation. Territoires hostiles à l’installation humaine, ce n’est qu’à partir du XXème siècle que certains entrepreneurs y voient un réel potentiel de développement urbain avec un nouvel intérêt dans les sports de loisirs de montagne et notamment le ski. En effet, dès le début des années 20, des premiers investisseurs s’intéressent aux villages de montagne à fort potentiels, comme le Baron de Rothschild pour le village de Megève au sein duquel il y développera un grand nombre d’infrastructures. Les progrès techniques amenés avec le développement de l’industrialisation, ont favorisé l’implantation des premières stations : grâce aux premières remontées mécaniques, le ski devient alors accessible à tous. La conquête des montagnes s’accélère à la fin de la Seconde Guerre mondiale : en 1946 est inaugurée la station de Courchevel 1850, la première station construite sur un site vierge. L’urbanisation de la montagne est alors lancée.
Les années 60 sonnent l’arrivée des Plans Neige, qui ont pour objectif de créer et d’aménager un grand nombre de stations de sport d’hiver en haute montagne. De 1964 à 1977, ce sont en tout 150 000 lits qui sont construits et répartis dans plus de 20 nouvelles stations et 23 déjà existantes. Ces nouvelles stations sont d’ailleurs des symboles de modernité : on y déploie des architectures novatrices, aux formes symbolisant les paysages de montagne, à la recherche d’une harmonie entre la ville et la nature. Les stations des Arcs, Aime 2000 ou encore Les Orres en sont des beaux exemples. On y construit des ensembles de logements aux pentes de toits assurées, avec des appartements de grande qualité, possédant bien souvent des terrasses et de grandes ouvertures sur l’extérieur. Ces architectures typiques des stations sont d’ailleurs aujourd’hui inscrites au patrimoine français du XXème siècle comme les chalets de HJ Le Meme à Megève, les immeubles de C. Perriand aux Arcs, Courchevel 1850, Flaine, Avoriaz ou encore Karellis.

Les immeubles de logement de la station savoyarde Flaine, imaginée par l’architecte Marcel Breuer, sont classés depuis 2008 “Patrimoine Architectural du XXème siècle” – Crédit photo ©️DimiTalen via Wikipédia
Aujourd’hui, les différents massifs montagneux français accueillent au total, 350 stations de ski. Les progrès techniques ont permis d’optimiser le fonctionnement des stations, en améliorant considérablement le confort de leurs usagers, ainsi que l’enneigement des pistes avec l’apparition de la neige de culture… L’arrivée du TGV en bas des pistes a également favorisé l’accès aux stations. Il est désormais possible depuis Paris d’arriver en 5 heures sur les pistes, une vraie révolution ! Mais pourtant, au-delà de ces progrès, un constat reste inévitable : les stations n’attirent plus autant qu’avant. Le manque d’enneigement dû au réchauffement climatique, le coût élevé des sports d’hiver et enfin bien entendu, la dangerosité du ski… Autant de critères qui en démotivent plus d’un.
Sans neige, quel avenir pour les stations de ski ?
Les montagnes françaises sont les premières à souffrir du réchauffement climatique en cours. Les effets y sont bien plus brutaux et plus rapides qu’ailleurs. D’après l’Observatoire régional des effets du changement climatique, les Alpes françaises, depuis 1960, ont connu une diminution de 30 % du manteau neigeux avec une augmentation de 1,6 degrés. Il neige de plus en plus tard et les saisons propices aux sports d’hiver finissent de plus en plus tôt, car avec l’augmentation de la chaleur ambiante, la limite pluie-neige grimpe de plus en plus, de 150 mètres pour chaque degré supplémentaire.
Pour lire la suite de l’article c’est par ici !